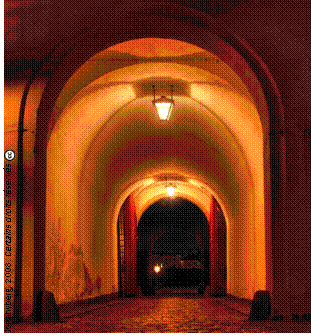Un esprit qui s’est élargi pour accueillir une idée nouvelle ne revient jamais à sa dimension originelle.
– Oliver Wendell Holmes
Quand on m’a proposé de rendre compte de ce 17e Atelier international de recherche et d’actions sur les inégalités sociales et les discriminations (note 1), j’ai hésité. Cette semaine d’échanges qui s’est conclue par une rencontre publique et qui visait à ouvrir des brèches dans la Fabrique des pauvres a, en ce qui me concerne, achevé d’ébranler les moellons d’une professionnalité de plus en plus souvent prise en défaut de résultats.
Je n’arriverais pas, même si je le voulais encore, à faire ici un compte rendu formaté « pro » des échanges, des analyses et des thématiques qui se sont dégagés d’une semaine riche de rencontres et de débats. Mais peut-être puis-je témoigner de l’utile, du précieux même qu’ont représenté ces quelques jours pris sur le temps (en grande partie rythmé par l’urgence) de ma pratique d’acteur du social et de la santé en contexte précaire.
De mon carnet de notes à la Revue du CREMIS, voici donc quelques traces, preuves d’un cheminement commun et des transformations qu’il a sans doute imprimées durablement chez celles et ceux qui y ont participé. Juste des notes, toutes empreintes de subjectivité dans leur contenu et dans leur forme aussi puisqu’elles sont présentées sous forme d’extraits plus ou moins développés autour de notions mises en avant dans nos échanges formels et informels.
Affrontement ou conflit ?
Il y eut peu d’opposition entre nous. Peut-être faut-il y voir le signe d’une constitution trop uniforme de notre groupe ? On échappe difficilement à une certaine homogénéité en période de lutte. Il est toujours plus facile de désigner des camps opposés. Et au sein du sien, de catégoriser les personnes selon nos schémas habituels : un chercheur, un expert du vécu, une militante, un professionnel, etc. Mais la désignation d’un ennemi commun porte un risque. Que la reconnaissance de ces autres aux prises avec tout ou partie de nos difficultés, ne débouche que sur des alliances de circonstances. Nous ne pourrons alors jamais nous interroger, collectivement, sur un projet plus large – débordant le cadre imparti – que l’on pourrait partager. Et nous en serons réduits à la seule considération des fins et des moyens.
A contrario, le peu de dissonance entre nous montre aussi que le groupe soutenu par la méthode de travail mise en place a pu éviter d’être dans l’affrontement. L’affrontement c’est de l’unidimensionnel : on est dans un « je » contre un « je » et son dépassement implique l’écrasement de l’autre. Il me semble que durant toute cette semaine d’échanges, nous étions davantage et sans même le savoir dans la disputatio (note 2) : questions, arguments et contre-arguments constituaient ainsi un espace de conflit, inséparable de sa permanence. Un conflit multidimensionnel que l’on ne pouvait dépasser que par la construction d’un « nous ». Un « nous » bien utile dans nos sociétés du rabattement sur l’individu de la responsabilité de son malheur, sur fond de discipline et de surveillance.
Pour certains d’ailleurs, leur présence aux ateliers était tout entière dans cette recherche et cette volonté de lien entre différents acteurs et dans la recherche d’un dépassement de leurs ancrages vécus comme trop homogènes. Nous partagions aussi une visée, le métissage des savoirs et des pratiques.
Situation
En préambule de la semaine, chacun fut invité à dire qui il était, d’où il parlait et à quels aspects de sa vie ou de sa pratique (dont on pourrait interroger la distinction ainsi faite) il prêtait aujourd’hui le plus d’attention.
Ce centrage sur nos personnes comme individus participant à l’atelier ne m’a pas particulièrement surpris. Dans l’après-coup, je pense que nous aurions pourtant pu y porter une attention particulière. Un des enjeux actuels tourne autour de la figure de l’individu (note 3). Cet individu que l’on veut voir concerné par ce qui lui arrive (pour le meilleur et pour le pire parfois), que l’on veut mettre en lien (avec lui-même et avec les autres), que l’on veut responsabiliser (pour qu’il devienne entrepreneur de lui-même). N’y a-t-il pas une contradiction à vouloir soutenir à tout prix le lien, le vivre-ensemble, la participation de tous, tout le temps en polarisant toute l’attention sur les seules caractéristiques individuelles ?
N’est-ce pas passer à côté du fait que nous ne sommes pas invités à nous lier les uns aux autres, mais que nous sommes liés ontologiquement aux autres ? Ces exhortations à refaire lien ne participent en fait qu’à faire croire que les liens entre les gens sont optionnels et nous incitent à en déduire que l’individu est toujours délié, séparé.
Difficile dans un tel contexte de se penser comme faisant partie d’une multiplicité. Or en tant que personne nous sommes toujours en situation (note 4), dans un donné qui nous échappe en partie, mais qui est toujours articulé à d’autres personnes. En substituant à la figure de l’individu qui est toujours définie par des catégories extérieures, l’idée d’une multiplicité en lien avec son milieu – non pas située donc, mais en situation –, on ouvre pour les personnes et on s’ouvre comme professionnel à l’expérimentation de formes d’intelligence collective.
Plus largement, se découvrir comme étant en situation, comme partie d’un multiple permet de se démarquer des références professionnelles et personnelles qui parfois polluent la réflexion. Et a comme effet de mettre en lumière le réel qui est si souvent masqué derrière la virtualité de la figure de l’individu.
Agir
C’est sans doute la volonté d’agir qui nous a réunis durant une semaine. Agir sur les nombreux éléments qui fragilisent, norment ou disciplinent de plus en plus les personnes et les comportements de tous et singulièrement des plus faibles dans nos sociétés. Comme acteurs du soin et de l’aide, nous posons souvent des actes et nous accomplissons nombre de missions. Mais en écoutant les non-professionnels qui prenaient la parole, je me demandais si faire était agir. Si on prête une oreille attentive à leur dire toujours ancré dans un vécu, on comprend que l’agir est ailleurs. Loin du contrôle de la situation que l’on attend toujours de nous. Loin de l’agitation, de la réaction conjoncturelle à la souffrance du moment, qui n’est souvent qu’une attention de quelques semaines ou de quelques mois.
L’agir est un terme que les non-professionnels prononcent parfois, mais qu’ils ne revendiquent jamais. L’agir dépasse les polarisations propres aux politiques et aux professionnels et développe des solutions en situation. Il articule les multiples composantes du problème plutôt que de les classer ou de les ordonner selon des critères toujours réducteurs. Il fuit l’hyperactivité et se réapproprie le temps. Cet agir, qui peut être commun, qui peut se partager n’est en revanche pas de l’ordre de la communication.
L’authenticité
Ce fut un des thèmes retenus pour la journée publique du vendredi. De quoi nous parle l’authenticité ? D’une justesse de l’être ? Mais qui la définira ? D’une justesse du propos alors ? Mais ne doit-on pas, ici aussi, s’inquiéter des louangeurs ou des censeurs ? À moins que l’authenticité dont il est question ne soit que la manifestation de nos relations concrètes à un moment donné et dans un milieu donné aux autres et au monde ?
Il me semble que quand nous parlions d’authenticité, c’était une manière de dénoncer la finalité utilitaire des hommes et des actions qui est aujourd’hui la règle. De dire que dans le réel des vies, il y a des choix et les conséquences de ces choix et qu’ils ne sont pas toujours raisonnables. Et que vouloir faire quelque chose pour ces vies, demande un engagement pour les transformer en vue d’une fin qui libère plutôt qu’elle n’assigne. L’authenticité est aussi la condition pour qu’une aide offerte puisse être acceptée ou refusée sans préjudice pour ces protagonistes.
Commun
Je porte depuis longtemps une réelle attention au commun des existences. Mais je n’ai aucune illusion sur sa possible construction à partir d’une modélisation qui viendrait d’un « en haut ». Même d’un « en haut » qui se parerait de garanties démocratiques ou scientifiques. Le commun n’est pas déterminable. Il n’a rien à voir avec le pacte social. Il est cette expérimentation que nous sommes tous « sur le même bateau ». L’ignorer permet parfois de gagner quelques batailles, mais finit toujours par nous faire perdre la guerre.
Ici aussi c’est des ponts entre pratiques professionnelles et citoyennes que pourra se dégager un commun indéterminé, mais porteur de sens. Il faut pour qu’il advienne, des pratiques dans lesquelles chacun peut déplier et choisir d’articuler ou pas son activité propre. Les savoirs des pairs aidants et des experts du vécu sont ici de la plus grande importance. L’attention des chercheurs à la bonne compréhension et à la bonne réception de ces savoirs doit être de tous les instants.
Pour autant, si le commun ne se décrète pas, on peut repérer les conditions qui le rendent possible. On imagine ainsi que la reconnaissance est un enjeu premier. Qu’il faudra refuser les relations asymétriques, penser les dispositifs de prise de parole, s’ouvrir à la proximité entre professionnels de première ligne et usagers vulnérables dans l’expérience commune qu’ils ont de ce qui les relie, etc.
Communication
Développer la communication, nous dit-on, est aujourd’hui un passage obligé pour avoir plus d’impact sur le politique et dans le public. Il est peu contestable que notre époque a fait de la communication, une obligation qui ne souffre aucun manquement, sous peine de non-existence. Vivre caché ne garantit plus de vivre heureux, mais peut vous condamner à ne plus ou ne pas exister. Comment dès lors imaginer une quelconque portée de nos actions si on n’est pas ? Pas d’échappatoire à l’impératif proclamatoire. Il faut composer le message pour le rendre audible et, peut-être composer avec le messager qui ne l’entend pas de cette oreille et avec un auditeur à l’ouïe tout aussi sélective. L’enjeu est, on l’a dit, existentiel. La conclusion s’impose d’elle-même. La communication, pour être un outil de contestation et pour nous permettre de résister à la surcommunication du camp d’en face, doit devenir ou être plus encore au rang de nos préoccupations.
Mais la communication ne doit-elle pas toujours venir en excédent de la pratique ? Penser les actions en pensant à la manière dont on va les communiquer, n’est-ce pas se condamner à les formater pour qu’elles entrent dans les cases du communicable ? D’autant plus dans un système qui a montré plus d’une fois sa capacité d’assimiler toute contestation, et ce jusqu’à sa propre contradiction. Et si tous nous communiquons sur nos actions, ne finirons-nous pas par accentuer le fond de bruit médiatique qui rend inaudible le discours ?
Le partage, le commun ne naissent pas de la communication, mais de la rencontre des créations en situation.
Entre authenticité bien comprise de l’action sociale et communication, devons-nous choisir ? Doit-on préférer engager le communicant plutôt que le travailleur social ? Doit-on se glisser dans les conditions de cadre du « There is no alternative » et y faire valoir nos revendications, ou la communication et ses professionnels peuvent-ils ouvrir des chemins de traverse, des à-côtés qui dérangent et transforment le cadre actuel ?
Connaissance
Plein feu sur les chercheurs. Et sur les nouveaux savoirs, qu’ils accumulent, qu’ils croisent et qui sont de plus en plus souvent compris et pris dans une logique utilitariste. Les agirs authentiques, que l’on différencie des actes, ne sont pas fort visibles dans une société qui mise massivement sur le pragmatisme et le retour sur investissement.
Les chercheurs, dans leur exploration des savoir-faire propres aux activités humaines, doivent aujourd’hui plus qu’hier se poser la question de l’utilisation de leurs recherches. L’enjeu ne porte pas seulement sur la compréhension de phénomènes (et sur la communication qui en est faite), mais sur leur connaissance (et donc sur ce qui les rend partageables). Deux conditions pour cette entreprise. Du temps et la re-connaissance d’une part d’ignorance dans les sciences humaines.
Les chercheurs, comme tant d’autres professionnels, doivent choisir leur camp. Seront-ils utiles ou subtils ( note 5) ? La distinction est tout entière dans le choix posé de recentrer un savoir sur le seul point de vue du commanditaire ou du chercheur, ou au contraire, sur la multiplication des points de vue et sur le travail de croisement réflexif qui en résulte. J’attends autant si ce n’est plus de la recherche qu’elle mette en lumière les processus en place et pas uniquement leurs effets. J’appelle aussi de mes vœux que les chercheurs rejoignent les professionnels et les non-professionnels dans la lutte pour faire advenir la portée non pas d’une vérité, mais des réels qui dans notre époque s’entrechoquent dans des rapports de force.
Experts du vécu, expérience
Cette semaine d’échanges nous a menés à de nombreux croisements, carrefours qui pourraient devenir – si l’on garde la métaphore routière – des échangeurs. Nous le savons, le savoir abstrait, logé dans les rayonnages des bibliothèques, mène à une somme d’informations, mais résiste rarement à l’épreuve du réel. En miroir, sans réflexion, la pratique débouchera toujours sur de la répétition d’où est exclue toute créativité.
Pour que l’échange se réalise et soit fécond, il y a une condition. S’ouvrir à l’intériorisation de toutes ces perceptions (des vécus, sensibles, théoriques, réflexives). On devine l’inconfort, sinon la dangerosité d’une telle posture. Elle met directement en péril les frontières que tous nous tirons entre citoyenneté et professionnalité, entre vécu et ressenti, entre soi et non-soi. Peut-être peut-on se rassurer en rappelant qu’il ne s’agit pas d’être dans l’un ou l’autre, mais de rendre possible la circulation entre ces différentes composantes d’une identité humaine. Sans doute peut-on en pâtir parfois, mais ces échanges renforcent aussi notre pouvoir d’agir.
La leçon des experts du vécu, des experts d’expérience qui met à mal la raison technique qui arrive massivement dans les sciences sociales, est que l’humain est un être de désir et que son excellence réside dans son imperfection (note 6). Par essence, il n’est pas spécialisé et résiste donc à la spécialisation des pratiques. Ne pas tenir compte de la leçon, pour le professionnel comme pour l’expert du vécu, transformera l’un comme l’autre en pièce d’une machinerie sociale incapable de créativité et gravement régressive.
Justice sociale
On s’en doute, dans nos échanges, plus d’une fois il fut question de justice sociale. À plusieurs reprises, nous avons soulevé le décalage qui semble augmenter entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Ce rabattement, jusqu’à l’écrasement parfois, du légal sur le légitime est une injustice et met en lumière le déséquilibre dans les rapports de force qui traversent la société. La tentation est grande à ce moment de s’instituer justicier. La figure de Robin des Bois n’est pas très loin. Mais le brigand au grand cœur parle d’une réalité qui n’existe pas. Il n’y a pas de société juste. Il n’y a pas de rupture dans l’injustice sociale, seulement des variations.
Pour rétablir la justice sociale on doit repenser la légitimité sociale de tous les individus. Or on voit tous les jours la mise en concurrence des figures de l’exclusion. Pour s’y opposer, il faut passer par des revendications concrètes (affirmatives) qui rappellent le commun de toutes les existences. Si l’on tente de rétablir l’équilibre d’une quelconque balance des comptes comme le faisait le brigand de Sherwood, on risque de définir une justice réduite à des notions de bien ou de mal, bien éloignée de la complexité du réel. Si l’injustice existe, c’est d’abord parce que nous pensons qu’un autre possible existe lui aussi. Il ne faut donc pas se contenter de rétablir un équilibre, mais chercher à créer de nouvelles modalités du vivre-ensemble.
Rétablir la justice sociale impose aussi de se dégager de la langue dominante. De mettre en lumière et d’interroger donc, les rapports de force. Et de partir, toujours, des formes concrètes d’injustice.
Sympathisant, militant, partisan
Militer. Le verbe (note 7) qui fâche, qui fascine, que l’on regrette ou qu’on appelle de ses vœux. Il faut s’en saisir pour réinventer ou dépasser cette figure idéaliste sans en perdre le contenu. Pour commencer, désillusionnons-nous. Si ailleurs existe, ce n’est pas pour un meilleur. Et si un meilleur existe, il n’est peut-être pas ailleurs. L’apport de ces rencontres transfrontalières est en partie dans la découverte ou le rappel qu’il n’y a pas de modèles (comme il n’y a pas de société juste) et que les programmes sont difficilement exportables. Et dans l’affirmation aussi que les réalisations pratiques et les essais sont toujours partageables et essaiment s’ils sont liés au développement d’une vie digne.
Il ne s’agit pas de s’interroger sur la nécessité qu’existe la militance. Dans les témoignages qui ont été faits tout au long de la semaine, nous avons pu voir qu’agir activement pour une cause qui importe rend possible bien des projets. La réalisation de toutes ces entreprises qui engagent ceux qui y participent s’est faite au départ de contextes fort différents. Progressivement, les personnes en situation qui y participent reprennent le pouvoir sur leur vie d’abord, autour d’elles ensuite, et sont à leur tour prises dans un débordement qui n’est pas toujours maîtrisé, mais qui répond à la résonance de leur création au-dehors.
Responsabilité
Pas d’innocent dans les couloirs de ces 17e ateliers. Nous participons tous au modèle socio-économique qui est le nôtre. Point de haute moralité dans cette affirmation. Juste le rappel qu’assumer cette responsabilité nous évite de devenir étrangers aux situations d’exclusion que vivent tant de gens aujourd’hui. Si nous n’avons évidemment pas fait le choix de ce qui dans cette société nous fait horreur, il est essentiel, pour pouvoir y changer quelque chose, d’en assumer notre part. L’accepter va permettre de mettre en lumière et de dénoncer le détournement de la notion de responsabilité quand elle est utilisée pour faire endosser à tous ceux qui ont « failli », la charge de leur malheur.
Aujourd’hui, être chômeur, usager de drogues, mère célibataire, pauvre, malade ou simplement défaillant fait de vous l’objet d’attention de toute une mécanique sociale. Et cette mécanique produit immanquablement de la responsabilisation sociale selon un schéma bien rodé. Premier temps, on aborde la personne selon le modèle de l’individu. Dans celui-ci aucune place pour des éléments extérieurs qui participeraient des difficultés rencontrées (crise du marché de l’emploi, faiblesse des systèmes d’éducation ou de santé, maladie…). Deuxième temps, glissement de plus en plus rapide de la position de victime à celle de coupable. La pauvreté ou le chômage ne sont plus les effets négatifs d’un système économique, mais désormais si l’on est pauvre ou chômeur c’est que l’on n’avait pas les qualités requises. Entre suspicion et indifférence, l’idée fait son chemin. C’est de leur faute si les gens sont dans la difficulté. Jusqu’à développer, pour reprendre les mots d’un participant, un racisme anti-pauvre. Troisième temps, surabondance d’offres de méthodes positives (note 8) pour ceux qui peuvent encore se les payer, et de contraintes tout aussi positives pour tous les autres. Elles visent à apprendre à chacun à modifier sa façon de penser, de sentir, de concevoir sa vie. Il ne s’agit plus de vouloir changer ses conditions de vie, qui d’ailleurs ne sont pas remises en cause. Mais de changer l’appréhension qu’on en a.
Les personnes se retrouvent piégées par cet escamotage de leur réalité sociale et des véritables causes de celle-ci. Elles tentent alors de s’expliquer en se trompant de registre. Elles ramènent tout à leurs supposées propres incapacités qui leur sont dictées de l’extérieur. Le quatrième temps a sonné. Il ne reste plus à la personne qu’à reconnaître sa culpabilité de ne pas être dans la norme de l’emploi, de ne pas poser les bons choix de vie, et à en souffrir dans les registres gracieusement mis à disposition de la psychologie et de la psychiatrie ou de la délinquance.
Technique
Au risque d’être caricatural, on peut sans doute dire qu’aujourd’hui les professionnels sont arrivés au bout de leurs outils traditionnels d’aide et de soin. De leur côté, les citoyens explorent des voix souvent innovantes, mais qui restent fragiles. De part et d’autre, c’est la création d’un système pérenne qui « prenne soin » de tous qui semble malaisée. Parce que chacun a sa petite idée sur ce qu’il « faut faire » tandis que dans le même temps peu de personnes misent encore sur un organe central pour sa mise en place.
Les techniques participent de cette situation. Elles ont modifié en profondeur notre rapport au changement en l’inscrivant dans un temps de plus en plus court. Elles se focalisent sur une partie des problèmes et n’offrent aucune garantie sur leur efficacité à long terme. Les politiques sociales par exemple, se succèdent, promettent toutes de solutionner l’une ou l’autre des formes de la pauvreté, mais produisent en même temps des effets délétères, car elles ne sont pensées ni dans la durée ni de manière globale. Le sens en est donné a priori et ne porte jamais que sur une partie des difficultés qu’il prétend résoudre. Les politiques sociales actuelles ne tiennent pas compte de l’inscription de la pauvreté dans un ensemble qui la dépasse de loin, mais auquel elle participe : pression sur les conditions de travail, renforcement de l’idée de méritocratie, désignation de figures négatives et repoussoirs, etc. Cette tâche aveugle – pour la technique – de l’utilité de la pauvreté n’est pas sans effet. « S’il y a des pauvres c’est qu’il y a des riches » a un jour rappelé quelqu’un. Terrible rappel que le malheur des uns concourt au bonheur des autres.
La technique s’étaye aussi d’éléments explicatifs puissants qui créent une nosographie sociale de maux qu’il faut traiter. On verse ainsi dans une naturalisation de la précarité qui est le revers de la normalité sociale (note 9). Tant que la pauvreté relevait d’une histoire, on pouvait parler d’injustice. Dès lors qu’elle devient un fait de nature, il n’y a plus de place pour une visée émancipatrice.
Il faut donc commencer par une affirmation. La technique est toujours un acte politique. Les rencontres et les croisements de pratiques et d’expériences, comme ceux auxquels il nous a été donné de participer, permettent de les interroger. On prêtera cependant attention à ne pas opposer la technique qui serait le fait des professionnels aux montages intuitifs portés par des citoyens. Un retournement qui dirait demain que l’initiative citoyenne est toujours la bonne est possible, mais il participerait du statu quo. Quelle que soit la justesse, la pertinence d’une pratique, et s’il y a toujours à apprendre des initiatives citoyennes et « locales » comme des approches professionnelles, c’est surtout pour en tirer un enseignement d’abord politique (et non pas technique) qui soit largement applicable. Penser ce qui protège des aléas d’une vie doit toujours avoir une portée le plus universelle possible sans jamais verser dans la généralisation.
Les participants à l’Atelier
Ibrahim Akrouh, conseiller juridique et chargé de recherche au Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie (MRAX), Bruxelles.
Jessica Albayrak, paire-aidante au Groupe d’intervention alternative par les pairs (GIAP), Montréal, œuvrant auprès des jeunes de la rue à l’équipe mobile de Médecins du Monde.
Doris Allard, organisatrice communautaire au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.
Lorraine Beauvais, chef d’administration de programmes des équipes jeunesse et scolaire au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Gestionnaire-chercheure au CREMIS.
Sylvia Bissonnette, coordonnatrice du Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec, un organisme fondé par le Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Membre partenaire du CREMIS.
Eliane Bonjean, Ecrivaine publique – Coordinatrice des actions sociolinguistiques, Ville de Grenoble.
Sophie Damien, référente sociale pour les projets bruxellois de Médecins du Monde.
Françoise De Boe, juriste, coordonnatrice du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, Bruxelles.
Nicolas De Kuyssche, directeur de l’association Le Forum Bruxelles contre les inégalités, réunissant une cinquantaine d’organisations et de services sociaux qui luttent contre les inégalités sociales.
François Denuit, doctorant à l’Université de Warwick et à l’Université Libre de Bruxelles, spécialiste de la politique sociale européenne en matière de lutte contre la pauvreté, l’exclusion sociale et le chômage.
Denis Desbonnet, journaliste, activiste et animateur, en charge des problématiques liées à la pauvreté au Collectif Solidarité Contre l’Exclusion, Bruxelles.
Ariane Dierickx, directrice générale, l’Ilot, Bruxelles.
Céline Galopin, historienne de l’art, médiatrice culturelle au sein de l’association sans but lucratif Article 27 à Bruxelles ; développe des projets artistiques avec des publics vivant dans une grande précarité.
Isabelle Gamot, Cheffe du Service Promotion de la Santé, Direction Santé Publique et Environnementale, Ville de Grenoble.
François Ghesquière, attaché scientifique et expert en inégalités sociales à l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS).
Baptiste Godrie, sociologue, chercheur d’établissement au CREMIS, professeur associé au département de sociologie de l’Université de Montréal.
Manu Gonçalves, co-directeur du service de santé mentale bruxellois, Le Méridien ; coordinateur santé mentale et précarités pour la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale.
Lazaros Goulios, Permanent interprofessionnel pour le syndicat CSC de Bruxelles en charge des questions relatives aux travailleurs sans emploi. Membre de la Coordination sociale locale du Mouvement ouvrier chrétien à Schaerbeek.
Chahr Hadji, éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif travaillant auprès de personnes sans-abri à Bruxelles.
Stéphane Handfield, étudiant à la maîtrise en sociologie à l’Université de Montréal.
Hélène Hiessler, Culture et démocratie, Bruxelles.
Eric Husson, coordinateur, Lama, ASBL bruxellois, centre ambulatoire médico-social de prise en charge d’usagers de drogues. Responsable, Concertation bas seuil (CBS), un groupe d’institutions qui regroupe la MASS de Bruxelles et le centre d’accueil de crise Transit.
Catherine Jauzion, cofondatrice du Café Touski, une coopérative de travail dédiée aux familles et résidents du quartier Centre-Sud, Montréal. Doctorante en sociologie, Université du Québec à Montréal.
Isabelle Laurin, chercheure d’établissement à la Direction de santé publique de Montréal dans le service Développement des enfants et des jeunes. Chercheure membre du CREMIS.
Jean-Baptiste Leclercq, sociologue, chercheur d’établissement au CREMIS, professeur associé au Département de sociologie de l’Université de Montréal.
Sébastien Lo Sardo, anthropologue, chargé de mission, Le Forum Bruxelles contre les inégalités.
Frédéric Maari, spécialiste en activités cliniques au programme dépendances du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Praticien-chercheur au CREMIS.
Céline Mahieu, sociologue, professeure à l’École de santé publique de l’Université Libre de Bruxelles.
Alain Maron, député écologiste, Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Christopher McAll, professeur et directeur, département de sociologie, Université de Montréal. Cofondateur et codirecteur scientifique du CREMIS. Fondateur et coresponsable des ateliers internationaux du CREMIS.
Geneviève McClure, Agente de planification, programmation et de recherche, volet développement de la recherche et animation scientifique, CREMIS (Montréal). Coresponsable des ateliers internationaux du CREMIS.
Deborah Myaux, Cellule aide alimentaire, Fédération des services sociaux, Bruxelles.
Tristan Ouimet-Savard, coordonnateur au développement des pratiques et à la défense des droits du Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ).
Mohamed Ouslikh, sociologue, Bureau d’étude du syndicat FGTB de Bruxelles.
Baptiste de Reymaeker, Culture et démocratie, Bruxelles.
Jean Spinette, Président du Centre public d’action sociale (CPAS) de Saint-Gilles et président de la Conférence des 19 CPAS bruxellois.
Georges Tonon, bénévole, maison d’accueil pour sans abris Les Petits Riens à Bruxelles. Expert du vécu au Service Public de Programmation (SPP) Intégration sociale et a la Direction générale aux personnes handicapées (DGPH).
Marc Uhry, Fondation Abbé Pierre (Europe)
Olivier Vangoethem, expert du vécu en matière de pauvreté et d’exclusion sociale pour le compte de l’Etat fédéral belge au Service Public de Programmation (SPP) Intégration sociale.
Bruno Vinikas, vice-président, Le Forum Bruxelles contre les inégalités.
Serge Zombek, psychiatre, responsable pendant trente ans d’une clinique générale au sein d’un hôpital public du centre de Bruxelles.
Notes
- Organisé en collaboration avec Le Forum Bruxelles contre les inégalités
- Comme au Moyen Âge, nous étions en effet pris dans une méthode d’enseignement et de recherche favorisant la discussion. Nos débats étaient oraux et publics. Au départ d’une thèse qu’on nous proposait, chacun faisait valoir ses arguments, pour terminer ensemble par les rassembler en une prise de position commune.
- Dans Miguel Benasayag, Le mythe de l’individu, Paris, La Découverte, 2004.
- Au sens philosophique du terme, on doit comprendre la situation comme une relation totale concrète de l’être vivant, tel qu’il est à un moment donné, et de son milieu ; en particulier d’un existant parmi d’autres existants. Dans André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 18e édition, PUF, 2006.
- Sur la distinction entre utile et subtil, on trouvera un intéressant développement dans un chapitre qui lui est consacré dans le livre de Pascal Chabot, Global burn-out, PUF, 2013, p. 67.
- Voir ibid.
- Soulignons que la définition de « verbe » en grammaire exprime l’action.
- Pour de plus amples développements sur ces questions, voir Claude Halmos, Est-ce ainsi que les hommes vivent?, Fayard, 2014, p. 245.
- Dans Guillaume Le Blanc, Vies ordinaires, vies précaires, Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées », 2007.
Contenu de cette page
Télécharger le document
Télécharger (.PDF)Auteurs
- Manu Gonçalves
- Co-directeur, Le Méridien, Service de santé mentale bruxellois et Coordinateur, Santé mentale et précarités, Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale
Numéro de la revue
Parcours imposés, territoires d'entraide (Vol. 9 • Numéro 1)Publications similaires

Synergie recherche-pratique : lâcher prise

15ième atlier international du CREMIS à Grenoble : inégalités sociales et recours aux soins et aux services sociaux

17ème Atelier international de recherche et d’actions sur les inégalités sociales et les discriminations du CREMIS, Brxuelles 2016 : des murs et des brèches